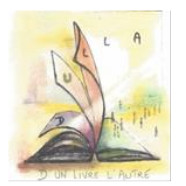La tête en arrière
Dans ce premier roman de Violaine Schwartz La tête en arrière, le personnage principal, une femme, habite une grande maison qui part à vau-l’eau. Elle est chanteuse, au chômage, fait des vocalises pour le projet de chanter « La voix humaine » de Jean Cocteau. Elle est aussi mère d’une petite fille qu’elle conduit régulièrement en garderie. Son mari est à Marseille pour son travail. Elle loue, pas cher, à un policier gabonais un studio au sous-sol de la maison donnant sur le jardin. Mais est-il vraiment policier ? Surtout elle se parle à elle-même, et c’est certainement ce qui est le plus « facile-léger-facile » chez elle, se dire « tu » et abandonner au lecteur les états d’âme de la cantatrice ayant buté sur « Carmen, la noiraude ». Un traumatisme, sans aucun doute.
Quand même, il s’agit de continuer à vivre, à s’occuper de la maison, organiser les espaces avec la chambre à courrier (qu’elle stocke et ne lit pas), la chambre à chanter, et se désoler du jardin à l’abandon. Garnir les pièces d’objets trouvés sur le trottoir, des encombrants à la recherche d’une nouvelle vie. Comme elle qui se dit : « Avant… ta vie était ta voix, ta voix était ta vie ». Et aujourd’hui ? Ne pas donner prise au délire, éviter de partir la tête en arrière, trouver les couleurs de la réussite (jaune ? orange ? vert ? beige ?) pour arranger la maison du bonheur.
La tête en arrière livre une femme en lutte, pas loin de la rupture, mais dotée d’une énergie folle. « Sportive et bien faite » elle court après le bonheur, mais le bonheur s’enfuit. Jusqu’au moment où, peinte par sa voisine artiste, elle devient elle-même une œuvre d’art et peut ainsi faire un sort au malheur.
DULLA
Comment on freine ? suivi de Tableaux de Weil
Dans ce livre il y a deux pièces de théâtre : Comment on freine ? Et Tableaux de Weil en trois séquences.
Comment on freine ? met en scène trois personnages : un homme, une femme qui vivent ensemble, et une femme bangladaise, dans un décor de caisses en carton pleines de vêtements, surtout des teeshirts fabriqués au Bangladesh. L’effondrement de la tour de Rana Piazza à Dacca le 24 avril 2013 et les 1133 morts, la responsabilité des grandes enseignes occidentales dans ce drame obsèdent la femme qui, entendant l’information en auto, a perdu les pédales (c’est le cas de le dire) et percuté un mur.
Comment on freine, alors ? Peut-être en s’appuyant sur le mur de livres que l’homme souhaite installer sur des étagères Ikea ? Pourtant le chœur des bouches criant l’infortune et la détresse des femmes bangladaises continue à animer les vêtements sortant des boîtes à la suite de la petite robe rouge, jusqu’à chanter le chant de révolte des tisseurs de soie de Lyon « Les Canuts ».
Tableaux de Weil est une pièce de théâtre à la mémoire de l’usine Weil de Besançon, fleuron de l’industrie textile où le travail à façon pour habillement masculin haut de gamme est joué et rejoué à partir des paroles des ouvrières et ouvriers ayant travaillé à la chaine en des machines de gestes, des mêmes gestes répétés pour « faire la production » en vestes et pantalons.
Violaine Schwartz réussit de manière splendide les scènes du théâtre de la pénibilité dans cette usine fermée en 1995 dirigée par des patrons paternalistes. Une belle mise en polyphonie des voix d’en bas !
DULLA
J’empêche, peur du chat, que mon moineau ne sorte
Le titre J’empêche, peur du chat, que mon moineau ne sorte est un alexandrin de Molière dans « L’école des femmes ». Le livre, une pièce de théâtre à quatre personnages : le Docteur ès peur, Lola aux chevaux blancs, son père et se mère, déjà morts, et aussi un oiseau Lilou, qui fut jadis la sœur jumelle de Lola avant qu’elle ne trouve la mort.
Le thème serait la peur, déclinée sous toutes ses formes, en s’appuyant sur l’origine grecque du mot ‒ phobie ‒ rattaché à tous les espaces générant la peur jusqu’à la chanson de Johnny Hallyday, « la peur », en passant par « le cri de guerre » des All Blacks, « le haka », proféré rituellement avant chaque match international de rugby.
La peur traitée à la façon du théâtre de l’absurde avec des touches de merveilleux, de fantastique, et une torsion de la logique ‒ à commencer par les morts qui parlent, le père et la mère ‒ qui essore les émotions et les abandonne sur des plages d’ironie, de défi et de langage argotique aux sons magiques.
J’empêche, peur du chat, que mon moineau ne sorte est une sorte de conte de fée avec des séquences de violence fantasmées quand l’angoisse s’installe dans le mental des êtres humains. Mais c’est du théâtre, car enfin, est-il possible qu’une mère se trompe à ce point en faisant la cuisine, prenant la cigüe pour du persil ?
DULLA
Le vent dans la bouche
Le vent dans la bouche est un roman où la narratrice se met dans la peau de Fréhel, chanteuse très populaire de la première moitié du XXe siècle dont la vie aventureuse se poursuivra au cinéma. Autrement dit, elle est habitée par cette femme hors du commun « reine lionne rousse, liane fauve » de Montmartre, interprète jamais oubliée de la valse musette La java bleue, enterrée aujourd’hui au-delà du périphérique, au cimetière de Pantin. Un lieu inconvenant, estime-t-elle, qui provoque son désir d’écrire au Président de la République pour qu’il décrète le rapatriement du corps de Fréhel au cimetière de Montmartre comme un autre président l’avait décidé pour le corps d’une autre chanteuse, La Goulue.
Au fil du roman le lecteur accompagne la narratrice dans les allées bordées d’arbres du cimetière de Pantin, écouter la voix de la chanteuse perdue dans le désert des rues de Paris où les music-halls ont laissé place aux commerces, sans trace de ces lieux de plaisir (à l’inverse des prisons, hôpitaux, gibets mentionnés par des pancartes), dans son voyage au Cap Fréhel, le vélo dans le train, cueillir des fleurs jaunes et revenir se recueillir sur la tombe. « Une escapade heureuse » dit-elle.
Le glissement incessant d’une Fréhel l’autre, à l’écoute de « la petite voix de l’hippocampe », dans le parfum des sycomores et à l’ombre des marronniers à fleurs doubles, dévoile aussi une personnalité changeante, préférant le végétal au minéral, la marguerite à la pierre. Et devant le rideau tiré, on entend comme un leitmotiv ces bribes de chant : « Fermez vos gueules, j’ouvre la mienne ! ».
DULLA
Une forêt dans la tête
Tout au long du roman Une forêt dans la tête la narratrice dont le lecteur ne connaîtra pas le nom se parle à elle-même. Elle dit « tu », se dit « tu », dit « tu » au lecteur, le prend à témoin avec délicatesse de son infortune, une rupture d’anévrisme.
Elle bénéficie de l’assistance de « la dame en blouse blanche » du service de rééducation de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui lui propose la méthode des empans de Daneman pour développer la mémoire immédiate perturbé par l’accident cérébral.
Mais elle ressent aussi la nécessité de partir de la ville, Paris, et de se reposer une semaine, sans Jean son compagnon, dans la montagne catalane où ils possèdent un mas croulant sous les ronces. Pas loin vivent Frida et René dans une cabane construite par eux à l’écart du village de hippies, des « yanouts » en catalan, c’est-à-dire des « laineux ». Pas loin non plus de Fris le joueur de djembé qui sait tout sur tout, débrouillard en diable, le cœur sur la main.
Marcher dans la forêt, se donner un programme de tâches, faire les cinq phrases quotidiennes, écouter Frida raconter sa vie d’« en dehors », apprécier l’aide de Fris, surmonter sa peur de la rupture d’anévrisme, telles sont les obsessions de la narratrice, personnage principal du roman.
Et celle-ci de trouver une solution qui s’esquisse en mode conditionnel. Plonger dans les rêves de belle vie en puisant dans la malle aux déguisements et sortir les habits et accessoires qui transforment la réalité. Peut-être ! Le millepertuis apporté par Frida fera-t-il sortilège dans un environnement chargé de trop de jaune (chambre, Jeep, salamandre) ?
DULLA