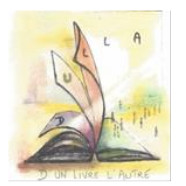Sylvie Durbec, l’amour et la liberté sans fin
Sylvie Durbec est une femme poète qui écrit en vers libres ou en prose comme cette Autobiographie de la faim qu’elle donne à la lecture. Une tentative de dire l’indicible, la vérité de ce qui existe et reste à l’écart, échappant à la raison. Une tension vers ce qui pèse d’un poids considérable : la folie. Pour ce faire : « Parler en se taisant. Retenir le plus possible ». Retenir sa langue pour découvrir une identité où le « je » circule dans l’entre-deux du père, inventeur de bonheurs minuscules, et de la mère, obsédée par la nourriture. Se laisser aller à « être simplement cette écriture, un serpent en moi, une coulée de boue, une douleur parfois, une joie ». Comment approcher les événements qui bordent cette soif de vie ? En un jeu de questions/réponses peut-être, ou bien en présentant des listes de mots, procédé très efficace « pour combattre l’impuissance et la mélancolie ». Stratégie des morts de faim, car si elle permet de faire naître une énergie nouvelle porteuse d’espoir, elle est aussi danger, car « la mémoire pue ». De la petite robe de la faim au pain de la faim ‒ le pain des fous ‒ le chemin n’est pas sans ornières qui pourtant est la voie où se « reposer de toute cette affaire maternelle ». Mais voilà cependant ce qui sauve : s’ouvrir au vent, au vif du vert, à la verdure pour aviver en soi « la prolifération verbale » qui permet d’honorer la tâche du jour : « mettre le mot fin à l’histoire de la faim ».
Les trois plaquettes de poésie dont nous allons parler sont en vers libres.
Chaussures vides, Scarpe vuote célèbre la nuit sans inquiétude, sans cauchemar, espace saturé de rêves, nuit blanche où se dessinent les arbres et les ailes des oiseaux ou le passage de l’ange. Bienfaisante nuit qui permet de pénétrer dans « un nouveau pays de la couleur invisible du temps » où surgissent les sources bleues si désirées des assoiffés revenant du désert. Face à la montagne, face aux forêts, le poète questionne, car « c’est le travail du poète de poser des questions » : qu’est-ce qui manque ? Le père peut-être qui ne « voulait pas qu’on lui achète de nouvelles chaussures » car il allait mourir. Ou bien Paul Brusson qui pratique l’art de la chaussure, arrêté par la Gestapo et enfermé au fort de Breendonk. Ou encore Sebald, le marcheur, ou Max le poète. Où va-t-on les pieds sans chaussures ? Est-il dans le vif de la mort, le « corps sans vertèbres ni chair » ? Questions qui se posent à Saorgue, dans la Vallée de la Roya où passent des migrants, à Willebroek en Belgique où un camp de concentration avait été ouvert par les nazis, mais aussi ailleurs.
Le paradis de l’oiseleur s’ouvre sur la mort de la huppe, oiseau somptueux s’il en est, messager de l’invisible, porteur de la joie dans une langue à inventer. Sylvie Durbec s’y essaie en mêlant sa langue poétique au chant du poète italien Giorgio Caproni. Des mots surgissent où le silence s’installe comme apprentissage de la patience alimentée par le souvenir du semainier et de la ritournelle maternelle. Faire l’expérience des yeux obscurcis avant la nuit et marcher dans les pas des « jeunes rêveurs » dont « leur peau parfumée n’est pas un vieux parchemin/rien n’y est inscrit que la joie d’être des vivants ». Aller au-delà d’un monde ruiné où l’oiseleur n’est pas séparé de l’oiseau, est-ce cela l’espérance ?
Ça, qui me poursuit, ce sont les mots qui orientent vers les chemins de la liberté, mais pas toujours ; d’où l’inquiétude et la lucidité de résister aux mots qui peuvent entrainer vers la perte. Donc la poésie en vers, substance inflammable où les mots tanguent et les lettres s’effritent si on ne les lit pas sur un rythme soutenu. Donc « des langues à tenir » comme l’aurige tient les rênes des chevaux de son attelage. Des bouches qui font silence, même pour dire ce que la langue continue de sorte que ce qui apparait c’est « la rage dedans ». Mais il y a cette réalité tragique : l’enfant triste sans d’autre secours que la plume de l’oiseau, sans l’oiseau. L’enfant, forcément garçon, car « une mère donc des fils ». Et se demander maintenant quoi faire, sinon écrire des vers, contre la violence du monde. Car les mots nous tiennent en vie et nous font aimer, même dans la nuit noire.
DULLA