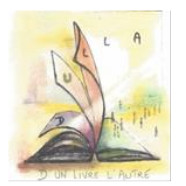Grand Paradis
Au commencement du roman d’Angélique Villeneuve Grand Paradis, il y a Dominique, sœur de Marie, à la recherche des traces de sa famille dans la bibliothèque de neurosciences Jean Martin Charcot à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris. Une recherche déclenchée par la trouvaille dans la cariole de Marie, un tantinet trash, d’une enveloppe kraft portant le prénom de « Léontine » et renfermant trois photos. Une quête d’identité aussi pour le personnage principal qui se réfugie volontiers près d’une pierre au milieu des haies qu’elle appelle pierre de Grand Paradis. « Mais pour tout apaisement, je n’avais que cela. La solitude et les herbes, mon Grand Paradis rongé de lichen jaune, aux abords bourdonnant du bois. »
Léontine Lenoir serait la grand-mère du père de Dominique. Elle aurait été atteinte de blépharospasme hystérique, une maladie des yeux, et soignée à la Salpêtrière par Gilles de La Tourette. Pour autant, le berceau familial serait Rochefort-sur-Mer puisque la première photo porte le nom du photographe « Delphin, 72 rue des Fonderies, Rochefort-sur-Mer » et que la mère, Louise Lenoir, est morte à l’hôpital de Rochefort, si près de la rue des Fonderies, aujourd’hui rue de la République. Entre les deux, Marthe Lenoir, la grand-mère paternelle, « une créature songeuse ». Que recherche Dominique qu’elle ne saurait voir spontanément, naturellement, explicitement ?
Ce que le lecteur sait d’elle ? Quelques traits de caractère, comme celui-ci : elle et sa sœur Marie, jeunes, aiment rouler à bicyclette, se « couler dans le paysage avant d’entreprendre quoi que ce soit. ». Et aussi qu’elle peut créer de la relation en regardant attentivement Jeanne A. à la Salpêtrière, puis en fermant les yeux pour mieux écouter le murmure de sa voix. « Il me semble trouver dans son chuchotement une sorte de promesse. »
Et si la collision des images n’était que le reflet d’un sentiment hystérique (comme l’on parle d’un sentiment océanique) qui ramperait jusqu’à Dominique à travers les siècles ? Une suggestion possible de ce très beau roman dont le côté obscur porte le nom d’une montagne magique, Grand Paradis.
DULLA
Un territoire
Très tôt dans Un territoire, ce roman singulier d’Angélique Villeneuve, le lecteur découvre un personnage malmené, une femme un peu sourde qui est identifiée comme « Elle ». Malmenée par un « Garçon » et une « Fille » dont les identités ne sont pas révélées. Son territoire est un cagibi dans une maison qu’elle connait bien pour l’avoir habitée toute jeune.
Les mots et les expressions violentes, « Elle » tente de les conjurer en se saisissant d’un projet : transformer une nappe de table aux bandes couleur orange en couvre-lit garni d’objets disparates et de matières diverses pour une destination étrange. On avance dans le roman avec les souvenirs exposés de l’enfance, la présence du « Père » et de la « Mère », et surtout celle de la « Sœur » cadette, silhouette de Marylin Monroe, jusqu’à ce repas donné pour fêter le 20e anniversaire de l’aînée, « Elle », où tout bascule.
« Elle » s’est faite une raison que d’être considérée par son entourage « un ballot de linge, une corbeille, une souche ». Cette situation comme un ancrage accepté est faufilée, cousue, peaufinée sans trop de souci car l’autre projet, lumineux, est aussi le commencement d’une autre vie.
DULLA
Nuit de septembre
Une femme a perdu son enfant. « Une mère orpheline d’enfant ». Existe-t-il une langue pour dire cela ? Oui, la narratrice trouve les mots sur l’ordinateur, des mots étrangers. L’un faisant référence à l’homme ; l’autre à la femme.
Son fils est retrouvé mort dans sa chambre. Un beau jeune homme de 21 ans. Elle se parle à elle-même ; un être en devenir chahuté par le passé récent. Le lecteur lit un texte à la deuxième personne du singulier. Tu te parles ; tu te dis ; tu te dis en disant la mort du fils ; ce mot qui, au pluriel, tisse d’invisibles liens. Tu ne veux pas dire la vie du jeune homme, une vie qui s’est arrêtée. Les mots courent comme une urgence. Les phrases galopent, et c’est comme si elles disparaissaient au fur et à mesure de la lecture, englouties dans l’intimité de la disparition du fils aimé. « Ce sont des mots noirs dont tu t’efforces de faire pâlir la violence ».
Le récit de la femme charrie une folle énergie pour dissiper cette absence. Les rêves comptent pour avancer malgré tout, c’est-à-dire malgré les traces de vie que l’enfant a laissées derrière lui dans son quotidien. Les choses banales de la vie d’un jeune et qui sont la richesse de sa personnalité. Et aussi la présence des platanes, arbres préférés de la femme, de la mère qui marche « à la recherche de la peau des arbres ». Avec assurance. Jusqu’au moment où elle entend dans une rue de Paris le prénom de son fils. Un prénom pas si courant.
DULLA
Les fleurs d’hiver
Le roman d’Angélique Villeneuve, Les fleurs d’hiver, publié en 2014, soit au moment où la France commence à commémorer le centenaire de la grande boucherie que fut la 1ere Guerre mondiale, est un grand roman de la tendresse, de l’amour, de l’empathie en temps de désastre et de barbarie.
Toussaint (c’est son prénom) revient de guerre, un bandeau sur la tête cachant la moitié de la face. Il entre, silencieux, dans le pauvre logement où vivent sa femme, Jeanne, et sa fille, Léonie, et se met à l’écart. Il écrit des mots noirs : « Je veux que tu viennes pas ».
Jeanne est ouvrière qualifiée dans la Naturelle. Elle compose, à domicile, des bouquets de fleurs pour une entreprise. Un travail délicat où il faut écarter « le mauvais rouge des pétales ». Un labeur où l’ouvrière voit tout en couleurs, même les yeux de Toussaint dans sa mémoire : « D’un bleu oscillant entre ceux de la nigelle et de la fleur de chicorée ». La connaissance des techniques d’un métier au vocabulaire précis sature presque l’espace domestique. Jeanne raconte à Toussaint dans l’ombre du lit « le métier de la Naturelle ».
Le lecteur reste à bonne distance de ce couple en train de se retrouver après quatre ans de séparation. Il faut du temps, pour l’un et pour l’autre, de se découvrir, l’un « gueule cassée », l’autre lumineuse dans l’éclat des fleurs, « pétales de nansouk dans la fuchsine ou le jaune picrique ». La présence enfantine de Léonie est aussi figure d’espérance, tempérée par la disparition de Sidonie, la voisine, dans le chagrin d’avoir perdu son fils, avec, encore dans les oreilles, les mots qui « giflent » du maire prononcés lors de la cérémonie de remise des diplômes aux « Morts pour la Patrie ».
C’est l’Armistice et la confiance dans l’avenir. « Les sons, les mots viendront peut-être. Pour commencer, ils iront se dire par la peau ». « Sous la langue, la peau nouvelle de Toussaint dessine les reliefs d’une écorce d’orange, parfumée d’une haleine sauvage. »
DULLA
Maria
Maria est shampouineuse de métier dans un salon de coiffure pour femmes. Elle travaille les cuirs chevelus comme des terres ensemencées. Elle vit une sorte de désarticulation du corps dès lors qu’elle ressent comme son petit-fils Marcus une familiarité d’espèces avec les oiseaux. « Les oiseaux sont une extension de son être ». Celui-ci, son être, annonce : « Plus tard, il saura voler ».
Pour l’heure elle accueille dans sa résidence Marcus qui préfère être prénommé Pomme, ce qui ne va pas de soi avec le compagnon de Maria. Céline attend un autre enfant. Le couple Céline-Thomas porte un projet de parentalité et garde le secret sur le genre du futur bébé. La liberté de choix des enfants est au cœur de leur manière de vivre, eux qui désirent secouer le monde.
Paradoxalement la forme de sérénité recherchée crée de la tension dans l’environnement familial. Maria veut savoir le sexe de l’enfant et pour ce faire profite d’un accident domestique pour trahir sa fille. Tourmentée, elle s’agrippe aux oiseaux. Cette sensibilité particulière aux oiseaux de toutes sortes la pousse à fomenter une aventure audacieuse que Céline prendra pour un vol, ce qui réjouit Pomme.
Angélique Villeneuve tricote une histoire fabuleuse en mêlant des cheveux d’ange à la laine des écharpes ; des plumes aussi. C’est ainsi qu’elle trouve son chemin de liberté et de dignité, elle qui se sent si bien liée aux êtres humains. D’une écriture en grande proximité des personnages, l’auteure révèle des qualités insoupçonnées, comme celle-ci : « Maria sait la couleur des gens, la couleur des sons et celle des odeurs. »
DULLA
La belle lumière
La belle lumière est la lumière qui roule sur les champs de rhododendrons en Alabama le long de la rivière Tennessee. Kate vit là, à Tuscambia, petite ville rurale, avec son mari Arthur, plus âgé de vingt ans, les fils de celui-ci et la petite Helen en proie aux fièvres qui la fragilise. Au service de la famille Keller, des familles noires s’activent sur fond d’histoire récente, celle des pratiques esclavagistes du Sud et de la Guerre de Sécession.
Kate voit Helen « comme si jour après jour la nuit était tombée à l’intérieur d’elle ». Mais « un corps combattant » la maintient en vie par l’odorat, le toucher, les vibrations du squelette, jusqu’à devenir violente. On cède à Helen jusqu’au moment où l’on fait appel à Miss Sullivan, une Yankee de l’Institution Perkins des Aveugles, société évoquée par Charles Dickens dans son livre Voyage en Amérique que Kate a lu, comme elle lit et relit Balzac. Miss Annie possède une méthode qui suppose de passer par des phases aiguës et laisse Kate dubitative : « Elle ne sait pas si c’est une victoire qui vient d’être remportée ou le début d’une longue glissade vers un inconnu effrayant ».
Kate vit dans la nostalgie de son pays, Memphis, Tennessee, où elle revient un temps, affrontant les fantômes de son enfance, où elle revoit le jeune noir Hilliot communiant avec les arbres, les oiseaux, les bêtes ; Kate dont le regard questionne : « Ces épaules. D’où lui viennent ces épaules ».
La belle lumière est ce temps recherché où il ne faut pas faire de vague. Où les roses ont une grande importance au point de faire venir de France des espèces de rosiers qui sauront retenir le goût de vivre et l’affection des morts. La belle lumière est surtout un magnifique roman d’Angélique Villeneuve sur la mélancolie, l’espérance et la ténacité.
DULLA
Les ciels furieux
Le beau roman d’Angélique Villeneuve Les ciels furieux entraine le lecteur dans une région de l’Est de l’Europe où l’on rencontre des shtetls, des villages juifs, en Russie certainement. En tous cas, il y a des Russes, des Juifs et des Juifs russes.
À la périphérie du shtetl vit une famille, parents, grands-parents, enfants, où chaque enfant est le bébé d’un autre plus âgé. Dans cette famille, on coud, on vit, et on s’appuie sur un Mensch, quelqu’un sur qui on peut compter. Pourtant des bandits arrivent. Ça n’a pas l’air d’un pogrom, mais l’idée vient au lecteur. Des bandits qui volent, pillent, saccagent, brûlent et où l’effroyable est suggéré. Des bandits russes.
Les figures du roman sont des enfants, une fratrie. Où l’on suit Henni, 8 ans, qui se réfugie dans une briqueterie ; Henni qui possède son univers de jeu et de sauvegarde, donnant un nom à chacun de ses doigts, noms de parents ; Henni et le bébé Iossif qui lui est prêté (le sien, c’est Avrom) et qu’elle se doit de protéger. C’est à hauteur d’enfant que se déroule le récit peuplé de rêves, de créations mystérieuses et fantastiques conjurant une réalité non pas terrifiante, mais dangereuse où Henni ne peut pas vraiment compter sur son grand frère Lev qui dit d’elle à un jeune gars : « C’est ma sœur ». Dédaigneusement.
Dans cette histoire circule une force de vie épousant le destin d’une communauté culturelle où l’on fête Shabbat, Pessah, Pourim, Roch Hachana, une force de vie silencieuse porteuse des facettes de la tragédie humaine. Et comme souvent dans les romans d’Angélique Villeneuve, il y a des oiseaux. Les oiseaux ouvrent sur un univers désiré où se tiennent des fantasmagories empêchant les étoiles de tomber. Une manière de se réconcilier le monde dans une sérénité symbolisée par un oiseau-fille attaché sur les épaules. Réussira-t-il à voler ? En tous cas, les phrases de ce superbe roman se déposent résolument avec souplesse et fermeté sur les pages, comme une invitation fraternelle à la lecture.
DULLA